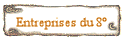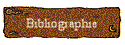31/5/2010 *
Avec les souvenirs de JJ. Roy
Rédigé par Maurice Charras
Monplaisir avait au moins 2 fabricants de condiments:
Vinaigrerie Exaltier
Au 2 de la rue Saint Romain la vinaigrerie déversait ses eaux de lavage rougeoyantes dans le caniveau en bordure du trottoir et en hiver ce caniveau
se bouchait avec le gel. Le liquide traversait la rue pour se déverser dans une
bouche d’égout de la rue St. Gervais. A l’époque la rue Saint Romain n’avait pas
le tout à l’égout et il fallait appeler la pompe à m… pour vider les fosses.
Les livraisons ou les expéditions étaient faite avec des
charrettes et un jour un cheval est mort dans la cour, son propriétaire a
enlevé sa casquette pour le remercier de ses bons et loyaux services (d’après
les souvenirs d’Andrée Boulaye). La vinaigrerie Exaltier fut fondée vers 1923 et s'arrêta aux environ de 1965
Moutarde SELECTA

Ce fabricant de moutarde se
trouvait au 26 du chemin de Grange Rouge (rue Maryse Bastié). Cette entreprise
fut crée en 1919 par Joseph Noiray (1887-1957) et Albert Declerek, lequel
vendit sa part le 14 décembre 1919 et le 23 mars 1920. Noiray s’associe avec Joseph Clerjon
(1893-1972) son beau-frère représentant de commerce. La société Noiray et Clerjon est installée au
rez-de-chaussée de la maison d’habitation de Noiray. Dans cette maison fut
servie la soupe populaire durant la guerre de 1914/1918. Dans le contrat passé
entre les associés il est stipulé que
la société versera un loyer annuel « en bonne espèce » de 2.400 fr payable en 2 fois : le 1°
janvier et le 1° juillet. L’apport de chaque associé est estimé pour le fonds
commercial et le matériel à 25.000 fr et Clerjon apporte 10.000 fr. Chaque
associé aura le droit de prélever « 1.000 fr à titre de traitement mensuel » La moutarde est vendue
sous l’appellation commerciale de
SELECTA.
Les débuts furent difficiles, la capitale de la
moutarde étant Dijon. La marque SELECTA eut droit à l’appellation Moutarde de Dijon, car cette appellation est un procédé de fabrication
et non une appellation d’origine.
Après
le décès de Joseph Noiray en 1957 et le retrait de Joseph Clerjon quelques
années après (milieu des années
60), la maison SELECTA périclita et ferma définitivement en 1977.


M. Clerjon M. Noiray
3. Fabrication chez SELECTA :


1 - Réception, contrôle et
nettoyage des graines. Elles arrivaient en sac de 50 kg pour être tamisées et débarrassées de la
poussière avant d’être stockées dans des silos à grains.
2 - Aplatissement: l'écorce des graines est fendue pour que l'amande puisse
bien s'imprégner de verjus (ou de vinaigre), avec 2 meules perpendiculaires.
Ces meules étaient périodiquement rectifiées par des spécialistes, elles étaient
entraînées par des courroies dont le moteur était en sous-sol. Il n’y avait
qu’un seul moteur pour toute l’usine, un arbre principal distribuait le
mouvement à toutes les machines avec des courroies plates qu'il
fallait très souvent, soit les retendre en les raccourcissant, soit en enduisant la face
intérieure d’une glu spéciale pour en faciliter l’adhérence sur les poulies
très souvent en bois ou en fonte.
3 – Trempage et malaxage dans le verjus (ou vinaigre) pendant
quelques heures dans d’énormes cuves sous abri. Joseph Noiray, bon vivant et
très blagueur, ne manquait pas de montrer ces cuves lors de la visite de la
fabrique. Il soulevait alors le couvercle et le visiteur suffoquait (sans
danger, je peux en témoigner) après respiration du gaz émanant de la cuve. Les
normes de sécurité actuelles ne permettraient plus de telles fantaisies !
4 - Broyage : deux meules rotatives assurent un broyage grossier,
puis plus fin.
5 - Tamisage (blutage) : permet la séparation de la pâte et du son (ou
enveloppe protectrice de la graine également appelée tégument)
6 - Stockage : de 48 à 72 heures pour la maturation, jusqu'à dissipation de
l'amertume (aussitôt après sa fabrication, la moutarde garde en effet un goût
amer).
7 - Malaxage : il désaére et homogénéise la pâte. Le désaérateur élimine les
molécules d'air qui oxydent la moutarde. Puis la moutarde repose dans des
foudres.
8 - Conditionnement : le
robinet qui permettait la mise en seaux, en pots, ou en verres était appelé
« chioteuse » Pour ceux que le mot pourrait surprendre imaginez donc de la moutarde sortant d’un robinet !
A l’époque il n’y avait point de
dosettes à remplir pour les restaurants. Pour certaines qualités de
moutarde on rajoutait de l’estragon et on laissait plus ou moins de son pour
obtenir de la moutarde à l’ancienne.

 M. Noiray. Photo vers les années 1920
M. Noiray. Photo vers les années 1920
La fabrique Sélecta
employait 4 à 6 personnes dont les 2 associés.
Après démolition de l'usine implantation de la grue. Photo prise en 2005  L'immeuble fini. Photo prise en 2010
L'immeuble fini. Photo prise en 2010

Vous avez dit moutarde ?
La plante:
Il y a 3000 ans, les Chinois cultivaient déjà
plusieurs espèces de cette plante crucifère à fleurs jaunes très courante en
Asie. Ils furent les premiers à en broyer les graines et à les mélanger à un
suc acide extrait du raisin, le verjus, afin d’obtenir de la moutarde.
furent les premiers à en broyer les graines et à les mélanger à un
suc acide extrait du raisin, le verjus, afin d’obtenir de la moutarde.
C’est au 14ème siècle, lors des fastueuses fêtes de Rouvres, que la moutarde
fait son entrée à la table des Ducs de Bourgogne. Elle devient synonyme de richesse et raffinement. Dès 1390, la fabrication de la moutarde de Dijon est strictement réglementée.
La moutarde, du latin mustum ardens, moût brûlant, est un
condiment préparé à partir des graines d’une plante oléagineuse de la famille
des crucifères ou brassicacées comme le colza, le choux ou le navet. Deux espèces sont utilisées dans la fabrication de la moutarde : Brassica Nigra, ou moutarde noire et Brassica Juncea ou moutarde brune.
Une définition :
Le verjus est un jus acide extrait de raisin blanc n'ayant pas mûri. Il
peut remplacer le jus de citron ou le vinaigre dans les vinaigrettes, les
moutardes, dans la préparation des plats de viande ou de poisson et dans la
préparation de sauces. Il s'utilise pour le déglaçage. C'est Jean Naigeon, un
Dijonnais, qui vers 1752, substitue le verjus au vinaigre. Cette recette fait
la renommée de la moutarde de Dijon.
Recette :
La moutarde de Dijon est faite
avec de la moutarde noire (brassica nigra). Sa graine est minuscule: environ
500 000 graines par kilo. Cette graine, sous la dent, ne pique pas. Elle a du
goût, sans plus. Cet épice, utilisé pendant des siècles dans cet état brut
(comme de la coriandre, du persil, du poivre, du sel), devient piquant
lorsqu'il passe par un processus chimique.
Des graines écrasées plongées dans un liquide quelconque (verjus, vinaigre, vin
blanc) fermentent avec le temps. La graine de moutarde renferme de la sinigrine
qui, hydrolisée au contact du liquide par une enzyme (myrosynase) fait
apparaître l'allylsénévol, huile essentielle qui donne le piquant de la
moutarde. Dans les pièces des usines où cette fermentation est mise en œuvre,
il est impossible d'y rester plus de quelques secondes car l'allylsénévol pique
les yeux et fait pleurer.
Gaz moutarde :
Il a été particulièrement
utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale. Nommé parfois
ypérite du nom de la ville d’Ypres, en Belgique, ou il fut utilisé la première
fois au combat le 11 juillet 1917, son nom vient
d'une forme impure du gaz moutarde dont l'odeur ressemblait à celle de la
moutarde, de l'ail ou du raifort. Les alliés découvrirent que le chlorure de
soufre, se fixant sous pression sur l’éthylène, permettait une fabrication
trente fois plus rapide que celle du procédé allemand
Cataplasme de moutarde :
C’est à dire appliquée en
bouillie sur le corps entre deux linges, la moutarde était autrefois utilisée
pour ses pouvoirs antiseptiques (qui combat les infections). En cataplasme
toujours, mais sinapisé cette fois, c’est à dire à base de moutarde noire et de
farine, la moutarde combat l’asthme et la pneumonie. Attention tout de même à
enduire l’épiderme du malade d’un corps gras car la moutarde est un produit
irritant. Ce même procédé permettrait d’apaiser la douleur, et de désinfecter
les plaies.
Moutarde ou sénevé ?
En français, on l'a d'abord appelée « sénevé » et, par déformation, « sanve ». Le mot « moutarde », qui est dérivé de « moût », n'est apparu que plus tard. C’est ainsi que dans les Évangiles l’on parle de moutarde :« Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et semé dans son champ. » (Mathieu 13-16-31)
Bibliographie:
http://dijoon.free.fr/moutardetechnique.htm
http://www.moutarde.com/page/29-la-moutarde-est-elle-ne-dijon/lang/1.html
http://www.cal-lorraine.com/culture/prof_calbert/moutarde1.html
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/HerbierMedicinal/Plante.aspx?doc=moutarde_hm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condiment
http://www.creapharma.ch/moutarde.htm
http://www.fallot.com
Moutardes et Moutardiers, Françoise
Decloquement, Bréa éditions, 1983
Petit
traité savant de la Moutarde, Françoise Decloquement, Equinoxe éditions, 2005